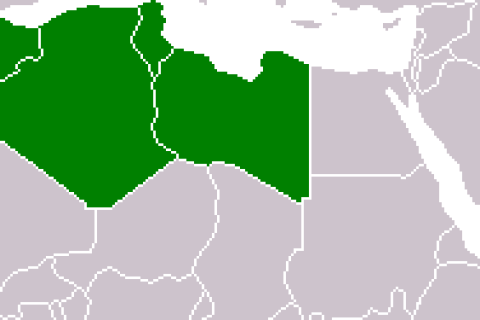Casablanca, la capitale économique du Maroc, est une ville d’affaires. Et elle est un creuset de cultures, un laboratoire architectural où le modernisme côtoie l’héritage colonial et traditionnel.
Et depuis quelques années, une nouvelle dimension s’est ajoutée à son identité : celle d’un haut lieu du street art. Ce mouvement artistique, autrefois cantonné à la clandestinité et à la marginalité, a trouvé à Casablanca un terrain d’expression fertile, transformant les murs gris en toiles vibrantes et invitant les Casablancais et les visiteurs à redécouvrir leur ville sous un angle inédit.
Mais précisons ce qu’est L’art urbain: Une expression éphémère et contestataire
L’art urbain, émergeant à la fin du XXe siècle, se présente comme un mouvement artistique distinct et un mode d’expression singulier. Caractérisé par son ancrage dans l’espace public, il englobe une diversité de techniques, du graffiti à la mosaïque en passant par le pochoir, s’éloignant ainsi des initiatives institutionnelles. Sa nature intrinsèquement éphémère, confrontée à un public large et hétérogène, le distingue fondamentalement de l’art « dans la ville » commandé par les pouvoirs publics.

Aussi ne vous attendez pas à des œuvres contestataires. on en est loin.
Au-delà de l’esthétique, l’art urbain se définit par son rapport critique au contexte dans lequel il s’inscrit. Il questionne, explore, marque et parfois même dégrade ou sublime l’environnement urbain, reflétant une dimension souvent subversive et contestataire. Les termes utilisés pour le décrire, tels que « pressionnisme » ou « post-graffiti », soulignent la richesse et la complexité de ce courant en constante évolution, témoignant de l’importance de la bombe de peinture comme outil d’expression artistique.
Le Street Art, nouveau visage d’une métropole
L’ascension fulgurante de Casablanca sur la scène internationale du street art est en grande partie due à l’association Alouane Bladi. Cette organisation joue un rôle crucial dans la promotion de l’art urbain, en offrant une plateforme aux artistes locaux et internationaux, en organisant des événements et en sensibilisant le public à cette forme d’expression artistique. Grâce à Alouane Bladi, un parcours de 12 km a été créé, invitant à la découverte de ces œuvres monumentales disséminées dans la ville, offrant ainsi une immersion au cœur du street art casablancais. Ce parcours, bien plus qu’une simple promenade, est une véritable exploration socioculturelle, une manière de comprendre comment l’art peut transformer l’espace urbain et interagir avec ses habitants.

Le street art, par définition, est un art éphémère, en constante évolution. Il est le reflet direct de son environnement, de ses préoccupations, de ses espoirs et de ses revendications. À Casablanca, cette réalité se manifeste à travers une diversité de styles et de thématiques. On retrouve des œuvres abstraites, des portraits hyperréalistes, des compositions géométriques, des messages engagés, des clins d’œil à la culture marocaine, et bien d’autres encore. Chaque mur peint raconte une histoire, offre une perspective, interpelle le passant. Cette diversité témoigne de la richesse et de la complexité de la scène artistique locale, qui s’inspire à la fois des traditions ancestrales et des influences contemporaines.

Mais regardons ce qu’est le « »Street Art » sur le plan historique:
Les années 1960 et 1970 marquent une période charnière dans l’histoire de l’art, témoignant d’un déplacement progressif de la création artistique vers l’espace public. Ce mouvement, qui préfigure l’art urbain contemporain, se caractérise par des interventions éphémères, contestataires et engagées.
L’émergence de l’Art urbain: Des gestes conceptuels aux bombes aérosols
En 1962, Yves Klein transgresse les conventions du marché de l’art en jetant des feuilles d’or dans la Seine, créant une « zone de sensibilité picturale » hors des galeries. Cette performance conceptuelle symbolise une volonté de démocratiser l’art. Dans la même veine, Gérard Zlotykamien réalise dès 1963 des peintures éphémères, soulignant la nature transitoire de l’expression artistique.

L’art s’engage également dans des luttes politiques. En 1966, Ernest Pignon-Ernest utilise des collages d’affiches au pochoir pour dénoncer le site nucléaire du plateau d’Albion, marquant une convergence entre art et activisme. Cette dimension contestataire est amplifiée en 1968 avec la production d’affiches politiques par le collectif de l’Atelier populaire, issues des revendications de Mai 68.
Parallèlement, une autre forme d’expression émerge aux États-Unis. Dès 1967 et 1968 à Philadelphie et New York, les premiers graffitis à la bombe signés font leur apparition, annonçant le développement du street art. Plus tard, en 1976, Jean-Michel Basquiat, Al Diaz et Shannon Dawson, sous le pseudonyme SAMO, investissent les murs de Manhattan avec des messages énigmatiques, rapprochant ainsi l’art de la rue du monde des galeries. En France, c’est Epsylon Point qui effectue ses premières interventions à la bombe dès 1979, consolidant le graffiti comme un moyen d’expression privilégié dans l’espace public.

L’effervescence du graffiti et de l’Art urbain dans les années 1980
Les années 1980 ont été une décennie charnière pour le graffiti et l’art urbain, marquées par une expansion explosive et une diversification des pratiques. Aux États-Unis, le phénomène des « writers » recouvrant métros et panneaux publicitaires, une forme d’expression et de revendication territoriale, s’est amplifié. Cette prolifération a coïncidé avec les premières tentatives de galeries d’art d’intégrer ces expressions visuelles, tout en confrontant un renforcement des mesures répressives.
L’Europe a également été témoin d’un essor créatif. Des figures comme Harald Naegeli en Suisse ont été poursuivies pour leurs interventions poétiques dans l’espace public. Parallèlement, des artistes comme Keith Haring à New York ont exploité des supports alternatifs comme les panneaux publicitaires vacants du métro. En France, dès 1981, Rafael Gray, Richard Hambleton, Blek le rat et Epsylon Point ont débuté leurs interventions, inaugurant une scène locale riche et variée.

Cette période a vu l’émergence de groupes et collectifs, comme Vive La Peinture (VLP), Banlieue-Banlieue, et les Paris City Painters (devenus la Force Alphabétique), ainsi que des artistes individuels tels que Jef Aérosol, Speedy Graphito, et Jérôme Mesnager. La scène française s’est également nourrie de l’influence du hip-hop, introduit par Bando à Paris.
L’année 1985 a été particulièrement significative avec des rassemblements d’artistes et la reconnaissance institutionnelle, à l’image de l’affiche de « La Ruée vers l’art » signée par Speedy Graphito. Malgré la répression et la marginalisation persistantes, les années 1980 ont constitué un moment crucial dans la légitimation et l’évolution de l’art urbain, jetant les bases pour son développement futur.
La fin des années 1980 marque une étape clé dans la reconnaissance du street art en France. En 1986, les premiers ouvrages consacrés au pochoir de rue, Vite Fait / Bien Fait et Pochoir à la une, témoignent d’un intérêt croissant pour cette forme d’expression artistique. La même année, la galerie du Jour / Agnès b. à Paris organise la première exposition dédiée au pochoir, consolidant sa légitimité. Des figures comme Ernest Pignon-Ernest, Miss.Tic, et André contribuent activement à l’essor de cette discipline.

Dans les années 1990, le graffiti hip-hop prend de l’ampleur, notamment grâce à la couverture médiatique. En 1990, l’East Side Gallery à Berlin devient un symbole de liberté et d’expression artistique. En France, le vandalisme urbain attire l’attention, avec notamment des tags à la station de métro musée du Louvre en 1991. Paradoxalement, le Ministère de la Culture, sous l’impulsion de Jack Lang, commence à soutenir le mouvement « tag » à travers des expositions comme ART CO’91, suscitant des débats passionnés.

Vers la fin de la décennie, le graffiti et le street art gagnent en visibilité internationale. En 1997, la parution du magazine américain While You Were Sleeping témoigne de l’intérêt croissant pour le graffiti. Des artistes comme Space Invader et Zevs (sous le nom d’ @nonymous) utilisent les médias pour diffuser leur art et provoquer des réactions, marquant une nouvelle étape dans l’évolution du street art, mêlant art, performance et critique sociale.
L’Émergence et l’institutionnalisation de l’Art urbain dans les années 2000
Les années 2000 marquent une période charnière pour l’art urbain, témoignant à la fois de sa prolifération dans l’espace public et de sa progressive reconnaissance par le monde de l’art institutionnel. La décennie débute par des actions spontanées, comme les collages de VLP et les interventions sur le MUR à Paris, soulignant la vitalité de la scène underground. Des expositions collectives, telles que celle de l’espace Tiphaine-Bastille en 2000, contribuent à structurer ce mouvement en mettant en avant des figures émergentes comme Space Invader et Zevs aux côtés d’artistes établis comme Blek le Rat.
L’année 2001 voit la multiplication des initiatives, avec l’affichage des portraits de John Hamon et la publication de la plaquette « Souvenirs de Paris », confirmant la présence durable de l’art urbain dans le paysage parisien. L’exposition « œcuménique » à la galerie du jour agnès b. la même année, rend hommage à Dondi White et illustre la diversité des courants, allant du graffiti historique au « post-graffiti ».
Progressivement, l’art urbain gagne en visibilité à l’international, avec la sortie du film « Bomb the System » à New York en 2002 et les premières installations de Hugman par Nathan Sawaya en 2003. L’ouverture de la galerie La Base 01 par Space Invader à Paris en 2003 témoigne de la volonté des artistes de se créer leur propre espace d’exposition.
La fin de la décennie est marquée par une institutionnalisation croissante. L’exposition « Le Tag » au Grand Palais en 2009 et « Né dans la rue » à la Fondation Cartier mettent en lumière des artistes internationaux, consacrant l’art urbain comme un mouvement artistique majeur. Ces événements, attirant un large public, confirment le passage de l’art urbain de la rue aux musées, tout en soulignant sa diversité et son impact culturel.

L’épanouissement de l’Art urbain dans les années 2010
Les années 2010 ont été une décennie charnière pour l’art urbain, marquée par une reconnaissance institutionnelle croissante et une démocratisation de la discipline. Le film de Banksy, « Faites le mur ! » (2010), a contribué à populariser la figure du street artiste. La publication d’ouvrages de référence, comme « The History of American Graffiti » (2011), a légitimé l’art urbain en tant que forme d’expression artistique et culturelle.
Des initiatives comme le festival Mural à Montréal (dès 2012) et le Parcours Street Art 13 à Paris (dès 2013) ont permis de rendre l’art urbain accessible à un public plus large, tout en offrant aux artistes des espaces d’expression légaux et valorisants. Des expositions dans des lieux prestigieux, tels que le Grand Théâtre d’Angers et le Palais de Tokyo, ont consacré l’art urbain, intégrant des figures majeures comme Dran, Shepard Fairey, et Invader. Le musée de la Poste à Paris a également contribué à cette reconnaissance avec l’exposition « Au-delà du street art ».
Cette décennie a aussi vu l’émergence de projets ambitieux, comme la Tour Paris 13, qui a réuni une centaine d’artistes internationaux. Des initiatives telles que l’In situ Art Festival et la Nuit Blanche à Paris ont transformé des espaces urbains en galeries d’art éphémères, mettant en lumière le potentiel créatif de l’art urbain.
La fin de la décennie a été marquée par la création de la Fédération de l’Art Urbain (2018) et la réalisation d’une Étude nationale sur l’art urbain (2019), témoignant d’une structuration du secteur et d’une volonté de mieux comprendre et soutenir cette forme d’art en constante évolution. Des lieux comme la Street Art City à Lurcy-Lévis ont offert des plateformes permanentes aux artistes, consolidant la présence et l’influence de l’art urbain dans le paysage culturel.
L’essor de l’Art urbain dans les années 2010
Les années 2010 marquent une période de reconnaissance et de démocratisation croissante de l’art urbain, auparavant souvent associé au vandalisme. Cette décennie voit la multiplication d’événements et d’initiatives qui contribuent à sa légitimation et à sa diffusion auprès d’un public plus large.
On observe la sortie de films comme « Faites le mur ! » de Banksy (2010), la publication d’ouvrages de référence tel que « The History of American Graffiti » (2011), et la création de festivals majeurs comme le festival Mural à Montréal (2012). Ces événements permettent de braquer les projecteurs sur des artistes et des pratiques diverses.
Des institutions culturelles commencent à s’intéresser à l’art urbain, organisant des expositions d’envergure, comme celle de Nicolas Laugero Lasserre à Angers (2012) et « Au-delà du street art » au musée de la Poste à Paris (2012). Des initiatives audacieuses, comme « Tour Paris 13 » (2013), transforment des espaces urbains en galeries d’art à ciel ouvert, impliquant des centaines d’artistes internationaux.
La décennie continue sur sa lancée avec des festivals comme « In situ Art Festival » (2014) et des événements nocturnes comme la « Nuit Blanche » parisienne (2014) intégrant l’art urbain. De nouvelles formes d’expression émergent, comme les peintures murales à grande échelle à Kiev.
Vers la fin de la décennie, des projets comme « Underground Effect » à La Défense (2015) et la « Street Art Avenue » le long du Canal Saint-Denis (2016) témoignent de l’intégration de l’art urbain dans le paysage urbain. Des lieux dédiés comme la « Street Art City » à Lurcy-Lévis (2017) offrent des plateformes d’exposition permanentes. La création de la Fédération de l’Art Urbain (2018) et l’Étude nationale sur l’art urbain (2019) témoignent d’une structuration croissante du secteur. En somme, les années 2010 sont une période cruciale pour l’art urbain, marquant son passage d’une forme d’expression underground à une forme d’art reconnue et valorisée.
Revenons à ce qu’on appelle le Street Art à Casablanca

La présence du street art à Casablanca a des implications qui dépassent la simple esthétique. Il contribue à la revitalisation de quartiers entiers, en transformant des zones négligées en espaces attrayants et dynamiques. Il favorise également le dialogue et l’échange entre les différentes communautés, en offrant un langage universel accessible à tous. En outre, il permet de démocratiser l’art, en le sortant des galeries et des musées pour le mettre à la portée du grand public.
L’impact du street art sur le tourisme est également indéniable. Casablanca attire de plus en plus de visiteurs curieux de découvrir cette facette méconnue de la ville. Les tours guidés organisés par Alouane Bladi sont devenus une attraction incontournable, permettant aux touristes de mieux comprendre l’histoire et le contexte de chaque œuvre. Le street art contribue ainsi à diversifier l’offre touristique de Casablanca et à renforcer son image de ville moderne et créative.

Toutefois, le développement du street art à Casablanca n’est pas sans défis. La pérennité des œuvres est un enjeu majeur, car elles sont exposées aux intempéries, au vandalisme et aux constructions nouvelles. La question de la légalité du street art se pose également, car certaines œuvres peuvent être considérées comme des actes de dégradation. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la liberté d’expression artistique et le respect de l’espace public.
Pour assurer l’avenir du street art à Casablanca, il est crucial de renforcer le soutien aux artistes, de développer des partenariats avec les institutions publiques et privées, et de sensibiliser davantage le public à l’importance de cette forme d’art. Il est également important de mettre en place des mesures de conservation des œuvres, afin de préserver ce patrimoine artistique pour les générations futures.
Inauguration et clôture du Street Art Tour à l’Institut Français
Cet événement, visant à promouvoir la créativité et la culture urbaine, atteindra son apogée avec un événement marquant : l’inauguration de nouvelles fresques.

Ce point d’orgue se tiendra sur l’esplanade de l’Institut français, situé au 123 boulevard Zerktouni. Choisir ce lieu pour la clôture du tour et l’installation de nouvelles œuvres n’est pas anodin. L’Institut français, par sa mission de diffusion de la culture, s’inscrit naturellement dans une démarche de soutien à l’art contemporain, y compris le street art.
L’inauguration des fresques offrira au public l’opportunité d’admirer le travail d’artistes locaux et internationaux. Ces créations, pensées pour s’intégrer à l’environnement urbain, apporteront une nouvelle dimension visuelle à l’esplanade. L’événement sera donc un moment de célébration de l’art urbain, tout en soulignant le rôle de l’Institut français comme acteur culturel engagé dans la promotion de la diversité artistique. La clôture de ce street art tour, marquée par cette inauguration, laissera une empreinte visuelle durable et contribuera à la dynamisation du paysage urbain local.
Casablanca veut se forger une identité unique grâce à son engagement envers le street art. Le parcours de 12 km proposé par Alouane Bladi est une invitation à découvrir cette nouvelle facette de la ville, à s’immerger dans un univers coloré et engagé, et à réfléchir sur le rôle de l’art dans l’espace urbain. Le street art à Casablanca voudrait être autre chose qu’une simple décoration murale, être un véritable langage, un reflet de la société, un moteur de revitalisation et une source d’inspiration pour tous ceux qui croisent son chemin. En continuant à soutenir et à promouvoir cette forme d’expression artistique, Casablanca semble vouloir consolider sa position de capitale marocaine du street art et continuer à surprendre et à émerveiller ses habitants et ses visiteurs. L’art, après tout, a le pouvoir de transformer une ville, de la rendre plus belle, plus vivante, plus humaine. Et à Casablanca, il semble bien parti pour réussir cette mission.
Gérard Flamme